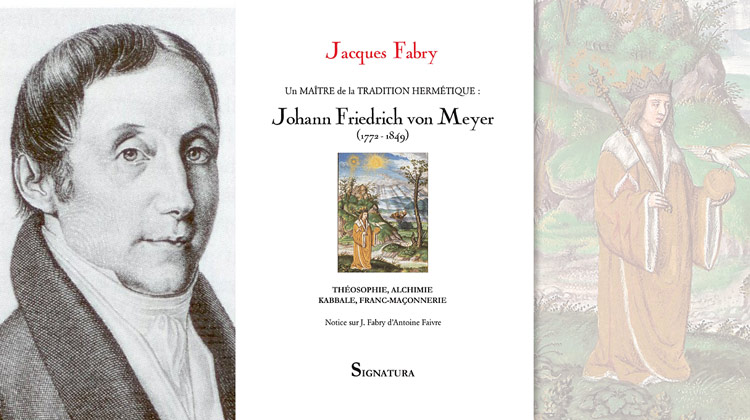Recension de l’ouvrage de Jacques Fabry : un Maître de la tradition hermétique, Johann Friedrich von Meyer (1772-1849), édition Signatura, 2014
Un tel ouvrage était attendu, réduction de la thèse d’Etat que Jacques Fabry avait soutenue en 1987, à l’Université de Haute-Normandie (Rouen), se fondant sur des documents originaux – dont il fut l’inventeur – dues à la plume savante de Johann Friedrich von Meyer (1772-1849) : ce dernier, ésotériste certes, ne manquait pas de sens pratique puisqu’il occupa des fonctions administratives qui le menèrent à la tête de la cité-état de Francfort. Il partage avec Goethe (1749-1832) non seulement l’origine géographique, bien qu’on l’oublie dans la liste des personnalités nées à Francfort, mais aussi, ou peu s’en faut, la contemporanéité bien que, malgré les efforts de Meyer, la relation entre les deux grands hommes ressemble plus à un divorce permanent qu’à une union fervente…
Le moins que l’on puisse dire, c’est que Meyer (le Francfortois, pour reprendre le terme de Fabry qui souvent l’interpelle tant les deux hommes semblent en totale affinité), homme de foi s’il en est, ne pratique pas celle du charbonnier ! Croyant, fervent chrétien, oui, mais à la lumière de l’érudition.
Cette réduction-synthèse, ce condensé de la thèse d’Etat monumentale dont il est issu, amène l’auteur à un maillage serré de ses révélations sur Meyer. L’original, certes très savant, possède une légèreté inattendue pour un tel travail universitaire sur un tel sujet. L’édition actuelle, au demeurant très belle, très soignée, paraît plus accessible car moins volumineuse mais demande au lecteur une attention soutenue de tous les instants. En effet, le travail de Jacques Fabry ne souffre pas le vagabondage, fût-il intellectuel : nous imaginons l’auteur, armé de la rigueur du chercheur et du trouveur, soucieux de présenter un Meyer presque universel, devant la rude tâche d’unir la vulgarisation inspirée à l’érudition la plus vaste, but de cette édition !
Jacques Fabry joue cette carte avec maestria, pédagogue dans l’âme et la pratique, homme de foi qui ne souffre pas la complaisance mais réussit à faire venir à lui les esprits peu enclins à trouver un quelconque intérêt à l’ésotérisme chrétien, tandis qu’ils sont petit à petit absorbés par les délires de la Silicon Valley ! Le seul délire de Jacques Fabry qu’il maîtrise réside en cette délectation, ce désir insatiable d’apprendre, et cela grâce aux travaux des maîtres qu’il s’est choisis : Herbort (1764-1833), Jung-Stilling (1740-1817), etc., auxquels il consacra études et ouvrages.
Cette publication nous fait vivre auprès de Meyer, grâce à l’écriture limpide de l’auteur, cette quête d’un Graal par essence inaccessible, ce qui lui confère son caractère sacré, tandis que ne cessent de s’offrir à nos yeux, aveuglés par de profanes images, des signes éblouissants et que se chuchotent à nos oreilles, assourdies d’un bruitage perpétuel, des confidences poétiques, les uns et les autres perceptibles par ceux qui sont faits pour cela. Il faut vouloir voir et entendre au-delà de la banalité quotidienne, jusqu’au point où cette banalité quotidienne devient révélatrice, à ceux qui possèdent l’humilité de s’ouvrir à elle, des grands secrets de l’univers, pour citer Maeterlinck (1862-1949) illuminé par Debussy (1862-1918).
La construction de l’ouvrage révèle le souci de clarté qui a guidé son auteur pour rendre accessible un sujet a priori si étranger à notre époque en s’attardant parfois, avec bonheur et pour notre joie, à l’homme Meyer, dépouillé de ses décors et des insignes de sa charge mais qui, pour autant ne cesse jamais de vivre sous la lumière de l’enseignement christique : Années de formation – Maturité – Ecrits majeurs –Johann Friedrich Meyer et la franc-maçonnerie I, II, III – Meyer théosophe (pensée symbolique et ésotérique) – L’Art d’Hermès – La Kabbale, chapitres suivis par une Conclusion qui tente une synthèse de l’œuvre à travers la personnalité du théosophe de Francfort.
Meyer révèle dans son Périodique pour une vérité supérieure (1818) ce qui l’entraîne à mener son esprit au-delà de l’immanence : « Chercher à se forger des ailes pour s’élancer au-delà des lois contraignantes de l’espace et du temps, » (p. 38). Homme prudent, Meyer n’est initié à la franc-maçonnerie qu’en 1827 : il trouve enfin chez les Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte (CBCS) « l’authenticité (du) christianisme et la richesse (du) rituel symbolique » (p. 57), l’orientation maçonnique qui répond à son exigence, lui qui avait auparavant critiqué vertement le laxisme dont se satisfaisaient certaines loges.
Si les affinités électives n’ont guère été mises en évidence entre Goethe (1749-1832), Wieland (1833-1813) et le Francfortois, le Mage du Nord, Johann Georg Hamann (1730-1788), malgré son goût des choses cachées et de la poésie, sa critique des Lumières et sa paternité du Sturm und Drang, n’a guère retenu longtemps Meyer. Il préfère se tourner vers un Jung-Stilling et un Gotthilf Heinrich von Schubert (1780-1860), auteur de la Symbolique du rêve. D’autres auteurs, certainement moins « grand public » comme Jakob Böhme (1575-1624), le philosophus teutonicus, Saint–Martin (1753-1803), Eckartshausen (1752-1803), Friedrich Herbort, Franz von Baader (1755-1842), sont pour lui des modèles, tandis que Hegel (1770-1831) ne trouve pas grâce devant ses exigences ; quant à celui qui lui inspire le plus de respect, l’illustre Emmanuel Kant (1724-1804), il n’est pas épargné non plus : cette incapacité de la raison humaine à surmonter les apparences, cette fuite de la chose en soi, cette frontière infranchissable pour le Maître de Königsberg, exposée dans sa Critique de la raison pure (1781, puis 1787), rétive à se laisser pénétrer, quelle que soit la puissance spéculative du philosophe, constitue la matière même de l’œuvre du Francfortois : le contenu de la Bible, particulièrement le Nouveau Testament, fondé sur l’enseignement du Christ, l’au-delà du tangible révélé par la foi, accompagné de la philosophie de la nature, héritée de Paracelse (1493-1541) pour lequel Ce n’est pas la nature qui suit l’Homme mais l’homme qui suit la Nature.
La gigantesque entreprise de Meyer fut cette traduction de la Bible (les deux Testaments) qui paraîtra en 1819. Jacques Fabry révèle, à l’occasion de la présentation qu’il en fait, se révèle plutôt, sa conception de l’hermétisme, le mariage du don poétique à la mystique (p. 33 : le hasard de la pagination…), se fondant sur une phrase de Meyer : « … mystiques, les voiles dans lesquels se drape la vérité biblique… » (p. 33). Quant aux poètes, ils sont de plain pied avec le monde des symboles, ils scrutent l’invisible. Laissons Meyer s’exprimer : « Le Verbe de la Bible […] parle à la fois au cœur, à l’esprit, à l’âme, il établit un lien profond entre la plus pure vérité et ce qu’on appelle la poésie » (p. 34).
Meyer est aussi un historien de la franc-maçonnerie, entreprise hardie, d’autant plus qu’elle se solde par une critique en règle de la confrérie. Le Francfortois déplore la légèreté des francs-maçons qui s’en tiennent pour beaucoup à une morale, certes respectable, mais insuffisante au regard de l’engagement pris dans la tradition des Mystères de l’Antiquité, des moines bâtisseurs, héritiers des constructeurs du temple de Salomon, des chevaliers du Moyen Age, gardiens des secrets des « sciences et des arts ». La foi chrétienne, liée à la résurrection, est le socle de tout engagement maçonnique.
La philosophie, telle qu’elle se présentait au siècle dit des Lumières, est dénoncée par Meyer : c’est une pensée réductrice. Pour le Francfortois, seule la vision symbolique permet d’entrer dans la vérité du christianisme, le symbole étant lui-même polysémique, mouvant comme l’est la vie sous toutes ses formes : une et multiple, pérenne et évolutive. C’est ainsi que l’on peut approcher la pensée de Meyer, escorté par un Jacques Fabry qui ne fait pas l’économie de sa passion, faite de sa foi chrétienne et d’exigence intellectuelle. Il semble souvent que l’auteur épouse son sujet, que Meyer est l’alter ego d’un Fabry, homo symbolicus talonné par l’homo logicus ! L’Esprit Saint, le Paraclet, couvre ces hommes de son aile maintenant qu’ils ont tous deux franchi les fleuves des Enfers, non étrangers au Grand OEuvre, à l’art d’Hermès, fondé lui-même sur ce qui constitue la règle du monachisme : orare et laborare.
Osons une longue citation : « La méthode de la philosophie rationnelle et celle de l’ancienne philosophie vraie sont en opposition. La première croit pouvoir créer abstraitement des concepts purs en éliminant tout ce qui est image sensible, ce qui n’est pas possible. Chaque mot est, en effet, une image symbolique et chaque concept un symbole, en ce que la raison ne peut s’imaginer les choses que selon les lois formelles spatio-temporelles et qu’une pensée pure, sans l’adjuvant de l’imagination, est une insuffisance impensable pour l’homme et le pur noumène une folie, » (p. 134). Ne peut-on y trouver plus belle approche de la poésie ? En effet, il semble que, pour Meyer, nous sommes toujours dans l’élan du faire, dans le mouvement de l’imagination animée de la foi.
Ainsi l’art d’Hermès, trois fois grand, rend compte de la mobilité du dieu, qui maintient cependant, gage d’une pérennité toujours en prise d’équilibre chevauchant les coursiers du temps et de l’espace (Giaour et Vortex ?) : ce qui est, dans le langage courant hermétique, ne serait donc que mouvements centripète et centrifuge, allers et retours entre l’archétype et la multiplicité de ses manifestations. Position du théosophe qui part de l’Un pour y ramener le multiple qui en est l’émanation. Le grand rassembleur est le Christ, « cette étoile du matin de la Kabbale », qui s’exprime en images symboliques. La Trinité se révèle dans l’alchimie : Père-Sel, Fils-Soufre et Esprit-Mercure… Jacques Fabry expose avec une virtuosité intellectuelle sans faille, à la suite de ces brillantes pistes, comment la Kabbale numérique s’inscrit dans le fait religieux, éternelle recherche d’une intercession entre l’agitation humaine, serait-elle intellectuelle, et la sagesse divine. Le rite demeure indispensable en tant que rappel de l’androgynéité de la Nature, nécessaire à maintenir la vigueur de la foi afin d’éviter les risques d’un anthropomorphisme réducteur, sombrant dans l’anecdotique. Quant au Christ, il se manifeste dans la philosophie de la nature, particulièrement dans le règne végétal (« Regardez les lys des champs,… »), dans cette harmonie, art musical d’union entre l’Un et le multiple.
Si la pensée de Meyer est un assemblage de mystique et de poésie, cette dernière servant de lien pour atteindre à la mystique, cela n’est pas sans nous rappeler le Descartes des Méditations : « On pourrait s’étonner que les pensées profondes se trouvent dans les écrits des poètes plutôt que des philosophes. La raison en est que les poètes écrivent par le moyen de l’enthousiasme et de la force de l’imagination : il y a en nous des semences de science, comme dans le silex, que les philosophes tirent au jour par le moyen de la raison et que les poètes, par les moyens de l’imagination, font jaillir et mieux briller. » Inattendue cette apologie de la poésie sous la plume du philosophe de la raison ! Ses animaux-machines feront les beaux jours du siècle dit des Lumières, lequel débouchera sur les abominations de Sade, les délires mécaniques et l’invention de cet outil à tuer, la guillotine, conçue par des médecins compatissants et un facteur de clavecins astucieux. C’est sur les puanteurs des massacres révolutionnaires que s’édifie l’exquise sensibilité spirituelle et poétique de Meyer, ainsi que, ô paradoxe !, les découpages savants ou non de Mary Shelley et autres.
Revenons à l’ouvrage de Jacques Fabry : il décèle en Meyer plus un théosophe qu’un théologien, les symboles étant plus explicites de l’intangible que toute étude ; la lumière (Urlicht), le vent et le feu, autant de signes par lesquels Dieu se manifeste. L’unité de Dieu s’inscrit dans le mystère de la Trinité qui se reflète dans toute la création, miroir, Sophia, « auto-révélation ternaire », matrice originelle « dont émane toute la diversité du monde créé » (p.149). La lumière divine est première et peut s’appréhender par l’Art d’Hermès, tandis que Lucifer (le porteur de lumière) s’enferme dans sa perversité narcissique, se gonflant jusqu’à vouloir se faire l’égal de Dieu, moment où la lumière divine se retire pour devenir ténèbres, jusqu’à régner sur cet empire de l’ombre. Meyer quantifie le nombre d’anges qui ont suivi Lucifer-Satan, un tiers de ceux-ci, auxquels Dieu envoya un maître, l’Homme, l’Adam, constitué d’un corps, d’une âme et d’un esprit, lequel ne manqua pas de chuter…, tenté par sa femme pressée par le serpent, animal lourd de symbolisme.
La chute de l’homme est donc due à la sensualité, au péché contre l’âme, c’est-à-dire la primauté accordée aux biens matériels, au péché contre l’esprit, « avant goût de la damnation » (p. 163), « spiritualité perdue » ! Les péchés d’Israël instaurent le désordre selon Meyer qu’on ne peut taxer d’antisémitisme, écrit Jacques Fabry, qui établit clairement une courte liste – dont notre temps donne malheureusement la preuve par un simple constat : « La première épreuve est l’aiguillon de la chair (la jeunesse), […] la deuxième (est) l’attrait de l’ambition, (…) de la vanité sous toutes ses formes » qui se manifeste par le goût du pouvoir (maturité de l’homme), ce qui débouche sur l’athéisme « dont toute spiritualité est exclue ». Remarquable de voir à notre époque le sectarisme de l’athéisme, d’ailleurs, qui taxe toute aspiration métaphysique d’obscurantisme !
Vient alors la question principale : unde malum ? Du diable, dit Meyer, qui a fondé l’Empire du Mal auquel succombe la volonté de l’homme qui demeure libre de suivre les commandements de Dieu ou non. « Nulle créature est innocente de sa chute » (p.169). Cependant Meyer rejoint la vision des théosophes d’une « sotériologie apocatastatique » : le mal aura une fin grâce au Christ et aux hommes de bonne volonté, ceux qui ont la foi : n’oublions pas que Meyer est luthérien, d’un optimisme qui inclut Lucifer dans « la joie de la renaissance ».
L’espace et le temps qui nous limitent laissent supposer qu’il existe un au-delà de ces « barrières » qui en sont le signe ; le ternaire esprit-âme-corps contient et exprime la vocation humaine, s’articulant autour de l’âme, siège de la foi, mariage du divin et de la nature.
Meyer fait l’apologie de l’alchimie, art d’Hermès, qui « réconcilie foi et savoir » (p. 185). Quant à l’alchimiste, il ne saurait se départir de son exigence. Meyer a cette phrase : « Il n’a pas une redingote pour aller à l’église et une autre pour aller au bordel ». La magie est présente dans le travail de l’alchimiste car il cherche à agir sur le monde (p. 186) : la magie est preuve d’« élection ». Osons citer notre temps opposé à tout élitisme : qu’en eût dit Meyer ? Le Francfortois demande « un cœur pur et des mains propres » pour devenir un adepte. Peut-on dire que le cheminement de l’adepte commence par la contemplation de la Nature ? N’est-ce pas Dieu qui s’y révèle dans sa splendeur et son amour ? Rechercher « l’infini dans le fini », voilà la voie indiquée par le Francfortois. Toujours sensible à la Nature, il apprécie particulièrement trois fleurs, symboles du cheminement alchimique : le pavot, le bleuet et la rose, particulièrement la rose rouge qui fleurit en toute poésie.
S’ouvre p. 211 le chapitre IX, consacré à la Kabbale, sagesse secrète transmise par la tradition orale, dont le peuple élu est le dépositaire, subtil jeu fondé sur la permutation des lettres, possible en hébreu, sorte de jeu de mots « cosmico-astrologique » (p. 211). La kabbale chrétienne fleurit à la Renaissance fondé sur le néo-platonisme (Pic de la Mirandole).
Meyer, d’après le portrait qu’en a dressé son fils Guido, était un sage dont émanait sérénité et sensibilité, animé par une curiosité intellectuelle universelle et un bon sens pratique que ne démentaient pas ses engagements politiques.
L’ouvrage de Jacques Fabry conserve tout au long de ses pages un souci d’information pour les profanes (dont je suis) sans céder à la condescendance ni à la facilité : c’est une initiation à un courant de spiritualité qui exprime ce besoin qu’a l’Homme d’une relation (homo religiosus) au monde métaphysique. Travail essentiel, lecture quintessentielle offerte par un homme de foi, auquel, depuis trois ans déjà, est apparue la lumineuses Vérité qu’il a cherchée tout sa vie.
Lestre, Pâques 2015
Sylvie Oussenko
Tous droits réservés